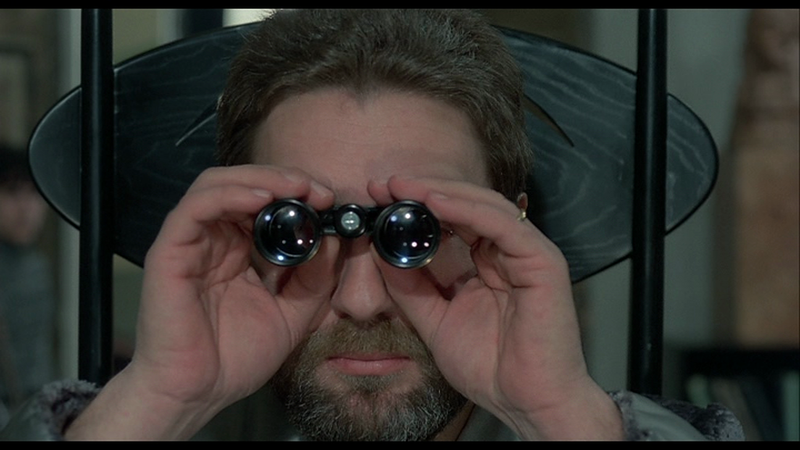La Chose révolutionnaire : la psychanalyse ?
La Chose révolutionnaire : la psychanalyse ?
texte présenté en 2018 lors des rencontres du collectif psychanalyse et politique à Toulouse, publié sur le site du pari de Lacan.
La révolution en politique consiste à  renverser un pouvoir, pour en mettre un nouveau en place. En cela, elle est conforme à la définition astronomique d’un mouvement qui repasse par un point, d’un trajet en boucle (autour d’un axe). Qu’est-ce que la psychanalyse a à voir avec la révolution ? Nous avons choisi de parler à partir de ce signifiant à l’occasion de l’anniversaire de la révolution russe, donc de sa dimension politique. Cependant, il m’a semblé qu’à partir de ce mot, nous pouvions aussi parler de psychanalyse, et ma première association a été une phrase de Freud qui me semble témoigner de la révolution impliquée (voire implicite) par la psychanalyse. « Wo Es war soll Ich werden » : dans un texte de 1955 Lacan montre notamment par cette formule comment l’invention freudienne a été déviée de son exigence première. C’est donc à « La Chose freudienne »1 que je fais écho aujourd’hui.
renverser un pouvoir, pour en mettre un nouveau en place. En cela, elle est conforme à la définition astronomique d’un mouvement qui repasse par un point, d’un trajet en boucle (autour d’un axe). Qu’est-ce que la psychanalyse a à voir avec la révolution ? Nous avons choisi de parler à partir de ce signifiant à l’occasion de l’anniversaire de la révolution russe, donc de sa dimension politique. Cependant, il m’a semblé qu’à partir de ce mot, nous pouvions aussi parler de psychanalyse, et ma première association a été une phrase de Freud qui me semble témoigner de la révolution impliquée (voire implicite) par la psychanalyse. « Wo Es war soll Ich werden » : dans un texte de 1955 Lacan montre notamment par cette formule comment l’invention freudienne a été déviée de son exigence première. C’est donc à « La Chose freudienne »1 que je fais écho aujourd’hui.
Le programme lacanien : le retour à Freud
Lacan parle de révolution copernicienne à propos de l’invention de Freud. Il faut y entendre que la boucle en question n’est pas un retour au même mais un progrès – comme il est attendu d’une révolution en politique – qui porte sur la dimension de la vérité que l’invention freudienne de l’inconscient a subvertie. Si ce bouleversement est comparé à celui produit par Copernic au XVIème siècle, c’est d’abord parce qu’il impose un décentrement de l’humain quant à lui-même, et provoque aussi quelques résistances. Il faut noter c’est que c’est aussi du côté des psychanalystes eux‑mêmes que cette résistance se fait sentir par un glissement doctrinal et pratique, que Lacan entend réviser.
Dans ce texte, Lacan argumente son retour à Freud. Il s’agit de redonner son tranchant à la psychanalyse par un retour au texte freudien pour lui redonner une interprétation plus ambitieuse, exploiter ce qui a été laissé de côté et qui pourrait contribuer à la réinvention de la doctrine. Il s’agit aussi de revenir à la pratique originelle, soit de rebrousser le chemin que la psychanalyse a pris après Freud en glissant vers les pratiques adaptatives sous la forme par exemple de l’ego-psychologie.
Tel est le programme de la révolution lacanienne, apparemment plus modeste que la freudienne. Elle s’avérait nécessaire en 1955, mais nous aurions tort de penser qu’elle s’est accomplie et que nous en sommes quittes. Nous avons à poursuivre pour la psychanalyse que nous avons l’ambition de défendre : une psychanalyse qui ne se range pas aux ordres du discours courant (adaptation, objectivation, management des âmes, etc.) et qui soutienne le symptôme, la singularité contre l’uniformisation.
La critique de Lacan vise donc le glissement qui s’est opéré depuis Freud : la psychanalyse est devenue une alliée du succès, du bonheur et de l’individualisme caractéristiques du monde libéral que nous habitons. Pour lui, « l’analyse ne débouche pas dans une éthique individualiste ». Pour Freud, « toute psychologie individuelle est aussi et d’emblée une psychologie sociale »2. Si après Freud cette inscription du sujet dans le social s’est perdue, sommes-nous assurés que la psychanalyse aujourd’hui ne soit pas retombée dans le même travers ? Dans une indifférence en matière de politique ?
Lacan a tenté de sortir la psychanalyse de cette déviance, c’est le sens de la révolution qu’il opère. Cette révolution n’assure aucun acquis. Il suffit de jeter un œil du côté des multinationales de la psychanalyse, de leur organisation et de leur « politique commerciale » (extension de la psychanalyse), jusqu’à une collaboration avérée au rayonnement du néolibéralisme en soutenant à grand renfort de slogans, Jupiter et sa révolution en marche3. Sommes-nous condamnés à une révolution permanente ? À tourner en rond pour nous assurer que ça tourne rond ?
La révolution freudienne : l’inconscient
La révolution freudienne, c’est la découverte de « l’inconscient refoulé » (qui fait retour) qui a pour conséquence que le moi n’est plus maître en sa maison, que « le sujet inconscient est excentrique au moi » comme l’écrit Lacan4. Le champ de la psychanalyse c’est le symbolique, le « district du langage » aussi bien que du symptôme, et c’est là qu’on repère l’égarement qui s’est produit après Freud dans un symbolisme naturel conduisant à l’idée que tout est langage. Il y a là un abus quant à la doctrine puisque la psychanalyse « toujours refait la découverte du pouvoir de la vérité en nous jusqu’en notre chair. » (Lacan, 1955). C’est donc « qu’il y a du véritable » comme dit Lacan, pour ne pas dire du réel.
La vérité mise en évidence par la psychanalyse, c’est ce qui parle, voire que ça parle. Et ce qui fait que ça parle est à situer dans le registre du réel – « ce qui revient toujours à la même place (Séminaire L.VII, 23 décembre 1959), à cette place où le sujet en tant qu’il cogite ne le rencontre pas » (Séminaire L.IX, 30 mai 1962) – en tant que pas tout saisissable par le langage, pas tout analysable. Disons les choses autrement : un sujet ne peut se saisir exhaustivement, se connaître entièrement. Il se méprend, se méconnaît, se pense unifié dans son moi et pourtant ça lui échappe, ça parle malgré lui, ça souffre et se plaint. Es et Ich ne font pas un si bon ménage. « Wo Es war soll Ich werden » écrivait Freud en 19325. La formule nous est parvenue dans une traduction réfutable : « le moi doit déloger le ça », qui indique assez bien l’ornière dans laquelle on a très vite mis la psychanalyse, à savoir une psychologie du moi. Lacan nous a proposé d’en sortir en reprenant la logique de la formule freudienne qu’il traduit plus rigoureusement par : « là ou s’était c’est mon devoir que je vienne à être ». Peut-on dire plus clairement à quelle révolution nous sommes condamnés ? Reprendre place au lieu de l’être, en cessant de démentir le réel, et consentir ainsi à la vérité qui parle en nous. Cette révolution, c’est le trajet d’une cure, rigoureusement détaillé par Pierre Bruno dans son livre Une psychanalyse : du rébus au rebut, dont je vous recommande la lecture. On pourrait aussi désigner ce trajet en disant qu’une psychanalyse va du symptôme (dont on se plaint) au sinthome (dont on se soutient). L’une comme l’autre de ces formulations indiquent un mouvement qui se boucle en un point qui se voit modifié par le mouvement de retour.
C’est ce à quoi la formule freudienne nous invite, inscrivant le procédé révolutionnaire dans son sens copernicien au cœur de l’expérience analytique. La révolution en question est d’abord subjective, il s’agit à minima de réviser sa position. Mais, en suivant Freud, elle ne vise pas l’individualisme puisqu’elle fait cas de l’inscription du sujet dans le rapport à l’autre. Mieux, elle s’appuie sur la prise du sujet dans le signifiant, de son aliénation à l’Autre, de ses déterminations signifiantes qu’elle déchiffre.
Que nous soyons aliénés au signifiant, c’est un fait que l’analyse dévoile. Sauf que le signifiant ne dit rien : il représente un sujet pour un autre signifiant, mais pris isolément, il ne veut rien dire6. Au mieux, les mots mentent et surtout quand on veut leur faire dire notre vérité. C’est le cas de la psychologie et avec elle des psychothérapies, dont la visée est toujours une certaine mise en conformité avec ce qu’on tient pour une vérité objectivable dans le savoir de ce qu’est et doit être un être humain : pratiques d’aliénation pourrait-on dire. La psychanalyse « pour se montrer parente de toute une gamme d’aliénations, […] les éclaire » dit Lacan. Le déchiffrage de l’inconscient permet de mettre au jour les coordonnées du fantasme donc du rapport à l’autre et à l’objet, et de saisir via la ronde des signifiants maîtres l’aliénation à l’Autre. Sans ce déchiffrage, pas de traversée possible, la condition première étant de consentir à la règle fondamentale.
On doit donc se soumettre à la règle analytique, mais cette soumission à laquelle consent l’analysant ne doit pas être pour l’analyste sa principale visée : il a à organiser les conditions pour une sortie possible, soit consentir à son renversement. Si le procès de la cure est un mouvement révolutionnaire au sens copernicien, l’analyste y contribue si et seulement si il consent, lui, à y occuper la place du rebut (Pierre Bruno). Si nous ramenions ce principe dans le domaine ordinaire des relations de pouvoir, l’analyste serait un maître assez particulier qui ne peut réaliser son projet qu’à la condition de mettre en œuvre la perte de son pouvoir. J’espère que vous saisissez comment quelque chose de l’ordre de la politique est à l’œuvre au cœur de l’expérience de la cure. Y a-t-il là des conséquences à tirer pour ce qui concerne la politique ? Je crains qu’il ne suffise pas de s’en inspirer, une telle position n’est sûrement pas tenable sans une cure parvenue à son terme.
La psychanalyse et la politique
Alors, quelle portée la psychanalyse peut-elle bien avoir dans le monde ? Si une psychanalyse est d’abord une affaire privée, elle concerne le monde dans lequel nous vivons (en tant que réponse au malaise, pour ne pas dire réaction au libéralisme) aussi bien qu’elle est concernée par lui (elle se doit de ne pas ignorer « la spire de son époque », et le psychanalyste est censé pouvoir « rejoindre la subjectivité de son époque »7).
Certes, elle ne vise pas à révolutionner le monde, mais elle propose à ceux qui sont candidats à la cure une révolution qui ne les changera pas, mais qui leur permettra de faire de leur symptôme une solution vivable pour eux‑mêmes et pour le lien social : tout sera donc changé pour eux. L’opération a un effet sur la jouissance qui dans sa forme première de « chemin vers la mort » (Séminaire L.XVII) prendra une valeur nouvelle qui permettra d’aimer la vie (le symptôme devient aimable une fois qu’on cesse d’en jouir pour s’en servir). Le produit d’une cure ne concerne que les quelques uns qui s’y engagent, ce qui laisse de la marge pour une incidence politique de la psychanalyse. Faudrait-il pour autant qu’elle soit généralisée ? « Plus on est de saints, plus on rit, c’est mon principe, voire la sortie du discours capitaliste, – ce qui ne constituera pas un progrès, si c’est seulement pour certains. »8 disait Lacan en 1973 dans son intervention télévisée où il insistait sur le fait qu’il ne réprouve pas la politique9. Ni lui ni Freud10, ne se sont jamais montrés indifférents à la politique. Ceci dit, ni l’un ni l’autre ne sont connus pour être des révolutionnaires. Si la psychanalyse intéresse la politique, ce n’est pas simplement du fait qu’elle se propose comme une révolution privée, mais parce qu’elle ne peut se concevoir hors du monde dans lequel elle s’exerce. Voire même, comme le suggérait Marie‑Jean Sauret à notre séance d’avant les vacances, qu’elle soit une (ou la) condition de la démocratie. Ce qui peut faire écho à cette formulation du Manifeste : « …le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous »11. On y entendra que l’universel ne saurait être satisfait si le singulier n’y trouve pas lui aussi son compte : en somme, un bel encouragement du symptôme !
La psychanalyse n’a pas vocation à diriger une révolution du peuple. Sa vocation première pour le dire d’une manière qui peut surprendre ceux qui ne sont pas familiers de la question, c’est de produire des analystes. Pas simplement d’écouter ce qui souffre, en quoi elle ne serait pas différente de la psychothérapie, mais de permettre à son terme l’émergence de l’analyste et de son désir, du Saint comme dit Lacan, en tant que « rebut de la jouissance »12, soit la condition pour pouvoir supporter de se faire pour le sujet de l’inconscient, la cause de son désir, et donc de pouvoir mener des cures. L’enjeu n’est pas la pérennité de la pratique de la psychanalyse, mais le maintient du discours analytique en tant que c’est le seul dont nous disposons pour que l’inconscient soit écouté de manière éclairée, dans la cure et hors cure. L’inconscient qualifié de « travailleur idéal » par Lacan, n’ex-siste qu’au discours de l’hystérique. Ce travailleur idéal dont Marx a fait « la fleur de l’économie capitaliste dans l’espoir de lui voir prendre le relais du discours du maître », c’est la politique : « l’inconscient c’est la politique13 », formule que nous relevions avant les vacances et dont Jean-Louis Sous a fait un commentaire attentif dans son livre14 qui lui est aussi est à lire.
Si la psychanalyse a quelque chose à faire avec la politique, c’est parce qu’elle propose un autre traitement de l’inconscient. Un autre traitement que celui entrevu par Marx selon Lacan, mais aussi un autre traitement que tous les autres discours. Il ne s’agit plus que de le déchiffrer pour mettre à jour l’économie subjective – au sujet de laquelle Jean-Louis Sous montre comment Lacan via Marx en a renouvelé l’abord. L’économie subjective doit s’entendre comme le jeu des investissements du sujet, comme la façon dont il est investi par les agencements institutionnels (l’Autre) et leurs rapports. La formule de Lacan, « l’inconscient c’est la politique », renvoie pour Jean-Louis Sous « le sujet […] aux régimes pulsionnels de son (a)ssujetissement et à ses modalités de complaisance ou de résistance (intimidation, humiliation, discrédit, résignation chantage, placardisation…). Là serait le droit de cité du sujet. » (p.26). Disons le autrement : une cure, au‑delà de sa dimension thérapeutique (puisque ceux qui y viennent sont quand même en souffrance), remet au sujet la responsabilité de son inconscient, soit de sa politique. Là où la psychothérapie vise l’éradication du symptôme, la psychanalyse conduit plutôt le sujet à en faire quelque chose (d’autre qu’une plainte) qui tire les conséquences de l’économie subjective mise à jour. L’opération psychanalytique produit un effet au niveau de la valeur si on suit la logique déployée par Jean-Louis Sous, « qui s’avère représenter un autre registre de la dimension du sens »15. Cet effet est de l’ordre d’une extraction, d’une chute, qui permet de mettre un bord (ou un terme) à la quête jusqu’alors infinie du (jouis-)sens et donc un délestage (de jouissance, au niveau)16 de la valeur.
Nous pourrions relever encore longtemps les occurrences dans les écrits psychanalytiques des implications politiques de notre discipline. Il y aurait un réel intérêt à faire ce travail, mais pour l’heure, une question s’impose : comment transmettre ce qui pour nous est sensible du fait de notre fréquentation du divan ? Cette transmission est‑elle vraiment possible ? Lacan a inventé la passe pour tenter de cerner ce qu’une analyse produit comme désir de l’analyste : on peut l’envisager comme une tentative de « transmettre hors divan ». Il y a probablement un travail de cet ordre à produire, de l’ordre du témoignage. Témoigner de notre rapport à la psychanalyse comme théorie mais aussi dans sa pratique, dans sa prise dans le monde. Faire un effort de transmission et de rigueur en faisant le pari que ceux qui veulent bien nous entendre ou parler avec nous sauront se saisir de ce qui peut leur permettre d’avancer dans leur champ de savoir. L’enjeu, au-delà du constat et parfois de la plainte, est d’engager un travail qui contamine en dehors du cadre de la cure et qui vise une sortie possible du capitalisme (sortir du capitalisme, ou bien le sortir de soi comme l’avance Pierre Bruno). Ne pourrait-on pas dire qu’il s’agit de faire école ? Pas dans le sens d’établir un savoir magistral, mais de nous risquer à une parole dont l’élaboration puisse avoir pour d’autres des conséquences, qui permette de s’orienter pour prendre position dans le monde. Cela passe par un retour aux concepts fondamentaux, pour les rendre transmissibles autant que pour les requestionner. Car si la dimension politique de la psychanalyse lui est intrinsèque, c’est sûrement dans son élaboration la plus exigeante qu’il faut s’engager pour en faire la démonstration. Et au-delà des constats et des idées, peut-être pourrons‑nous tirer des conséquences qui renouvellent aussi bien la psychanalyse que le lien social ?
Albi le 17 octobre 2017
Post-scriptum :
Nous envisageons de donner à notre collectif la forme d’un séminaire pour répondre à ce désir de transmission et d’échanges pluridisciplinaires, un séminaire au sens (étymologique) de pépinière où il s’agirait que chacun sème ses graines avec l’intention que ça pousse (être poussé par ses graines, et que ça pousse aussi les autres). J’y rajouterai l’invitation à suivre les travaux qui se tiennent l’après‑midi sur la proposition d’Élisabeth Rigal et Fabienne Guillen, sur la question du symptôme.
1in écrits, Paris, seuil, 1966.
2« Psychologie des foules et analyse du moi », 1921.
3Lire les Lacan quotidien de la période de la dernière campagne électorale.
4dans ses « Notes en allemand préparatoires à la conférence sur la Chose freudienne » (Pas-tout Lacan, site de l’ELP)
5Dans les Nouvelles conférences sur la psychanalyse
6Banane, exemple emprunté à Marie‑Jean Sauret, renverra selon le contexte au rocker, au fruit, au sourire, ou bien sera une qualification un peu moqueuse.
7« Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, Paris, Seuil, 1966. p.321
8Jacques Lacan, Télévision (1973) in Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p.520.
9Idem, p.517.
10cf. « Pourquoi la guerre », ou encore le Malaise dans la civilisation.
11Karl MARX – Friedrich ENGELS, Manifeste du parti communiste, Paris, Éditions Sociales, classiques du marxisme, édition bilingue, 1972, p 89.
12Télévision, p.517 des Autres écrits.
13J. Lacan, La logique du fantasme, séminaire inédit, leçon du 10 mai 1967
14Jean-Louis Sous, Lacan et la politique (De la valeur), Toulouse, Érès, 2017
15Idem, p.105.
16Parenthèse rajoutée après l’exposé le mot « délestage » ne me paraissant pas exact.